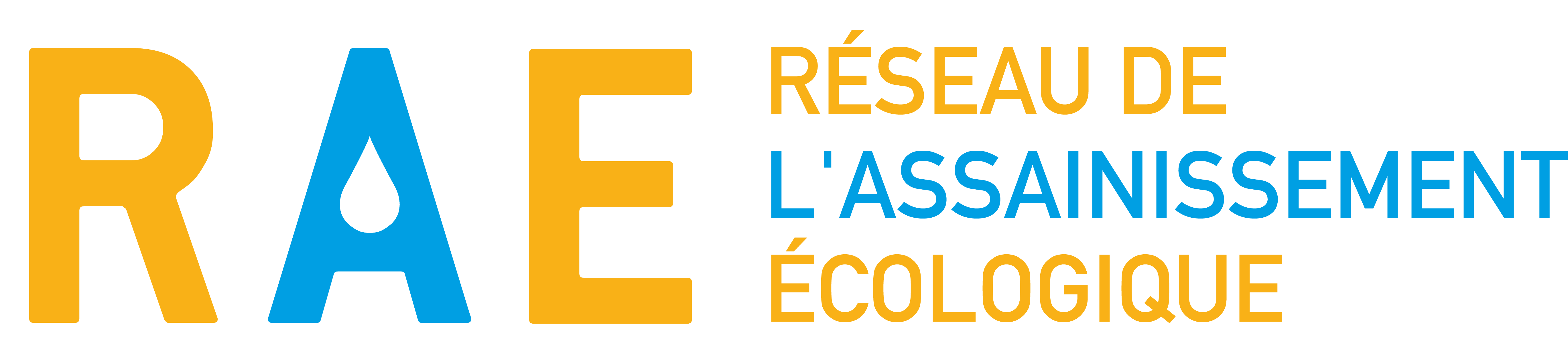Réglementation
A télécharger : FAQ – EXPÉRIMENTATION NATIONALE FILTRE À BROYAT DE BOIS
L’arrêté du 30 mars 2023 pour l’expérimentation des filtres à broyat de bois a été publié au Journal Officiel du 26 avril 2023.
Les projets de moins de 20 équivalent-habitants souhaitant participer à l’expérimentation peuvent candidater (avec votre de dossier de candidature complet – voir plus bas) directement via l’adresse mail suivante : experimentations.anc@developpement-durable.gouv.fr
Le réseau de l’assainissement écologique, via ses structures membres ou formées par le RAE, propose d’accompagner les porteurs de projet afin de les aider à réaliser un système répondant aux règles techniques définies dans l’arrêté.
- Réalisation de l’étude de conception
- Possibilité d’accompagnement au chantier
Accompagnement du RAE
Une contribution financière sera demandée pour l’accompagnement (montant défini par l’accompagnateur).
L’étude de conception et l’accompagnement au chantier sont deux étapes distinctes. Pour toute question et demande d’accompagnement, veuillez utiliser le formulaire de contact.
Est-ce que toutes les candidatures seront retenues et pour quel type de suivi ?
L’expérimentation se fera sur 30 projets et prévoit 2 niveaux différents de suivi in situ :
- expérimentation classique (26 unités) avec collecte de données d’observations par l’usager ;
- expérimentation approfondie (4 unités) avec plaques poreuses pour analyse physico-chimique des eaux ménagères traitées (paramètres de la matrice eau du sol).
Le comité de sélection propose au porteur de projet sélectionné le type de suivi.
Les projets devront respecter les règles techniques et avoir un dimensionnement de moins de 20 équivalent-habitants. L’objectif de l’expérimentation est d’avoir un panel le plus représentatif possible, pour ce faire nous cherchons un maximum de candidatures.
Mes engagements
Lorsque mon projet est sélectionné :
- réalisation du chantier en corrélation avec le comité pour la mise en place d’équipement de suivi selon le type d’expérimentation (classique, allégée, approfondie) ;
- transmission à votre SPANC du dossier de candidature et du document attestant votre participation à l’expérimentation ;
- transmission annuelle au comité du cahier de vie comportant vos observations à partir de la date anniversaire de la mise en eau ;
- possibilité de visite sur site par le comité.
Qu’est-ce ça me coûte ?
Le coût de mise en œuvre du système d’assainissement est à la charge du porteur de projet.
La mise en place des équipements de suivi (plaques poreuses pour les analyses physico-chimiques) est prise en charge par l’expérimentation.
Procédure de candidature et délai
● Remplir le dossier de candidature
● Envoyer le dossier de candidature complété par email à : experimentations.anc@developpement-durable.gouv.fr
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 26/04/24.
Suite à la candidature, si vous ne recevez pas de réponse sous 2 mois, la candidature est considérée comme rejetée. Dans ce laps de temps, le comité peut vous informer d’un prolongement du délai d’instruction en vous indiquant que votre dossier est en cours d’instruction.
Dossier de candidature
Le dossier de candidature comprend plusieurs éléments :
- dossier de conception permettant de vérifier l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi (type dossier déclaration SPANC) ;
- un engagement à transmettre annuellement le « cahier de vie » de l’installation
- un engagement qui autorise des visites du site par le comité pour vérifier le bon fonctionnement de l’installation ;
- un engagement qui autorise le comité à installer des équipements de suivi ;
- un engagement à ne plus se servir de l’installation en cas de suspension ou d’interruption de l’expérimentation ou dans le cas où expérimentation n’est pas suivie d’une généralisation.
Dans le but de faciliter les démarches, le RAE propose ce formulaire de candidature. Il n’est pas obligatoire de l’utiliser, vous pouvez également vous en inspirer.
Vous trouverez les règles techniques dans la publication de Pierre & Terre sur l’assainissement écologique : à télécharger ici.
Quel est le rôle du comité ?
Le comité se réunit plusieurs fois dans l’année pour sélectionner les projets. Il assure également le suivi de l’expérimentation. Pour cela il peut être amené à réaliser des visites sur site et à installer des équipements de suivi. Il reçoit également les cahiers de vie des installations.
Il réalise un bilan annuel de suivi basé sur les informations des porteurs de projet (cahier de vie).
Le comité peut décider se suspendre ou mettre fin à l’expérimentation pour un projet donné ou l’ensemble des projets.
Et le SPANC ?
Le porteur de projet sélectionné informe le SPANC de son territoire, via l’envoi du dossier de candidature ainsi que le document attestant de sa participation à l’expérimentation.
L’installation est considérée comme conforme dès lors qu’elle respecte les dispositions de l’arrêté ainsi que les dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2009 qui n’ont pas été dérogé par cet arrêté.
> Dossier de candidature pour l’expérimentation des filtres à broyat de bois <
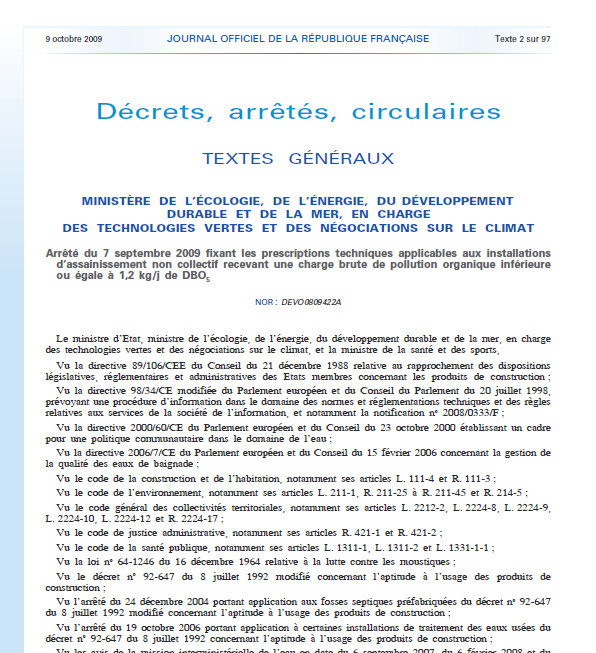
Arrêté du 7 septembre 2009
Arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Comprend l'Article 17 au chapitre V "Cas particuliers des toilettes sèches : Les toilettes dites sèches (sans apport d'eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à la condition qu'elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines."
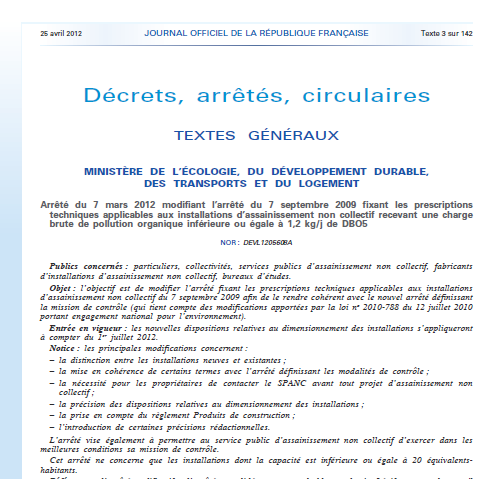
Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009
Cet arrêté apporte des précisions pour se conformer aux dispositions de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques et la loi portant engagement national pour l'environnement, dite "Grenelle 2".
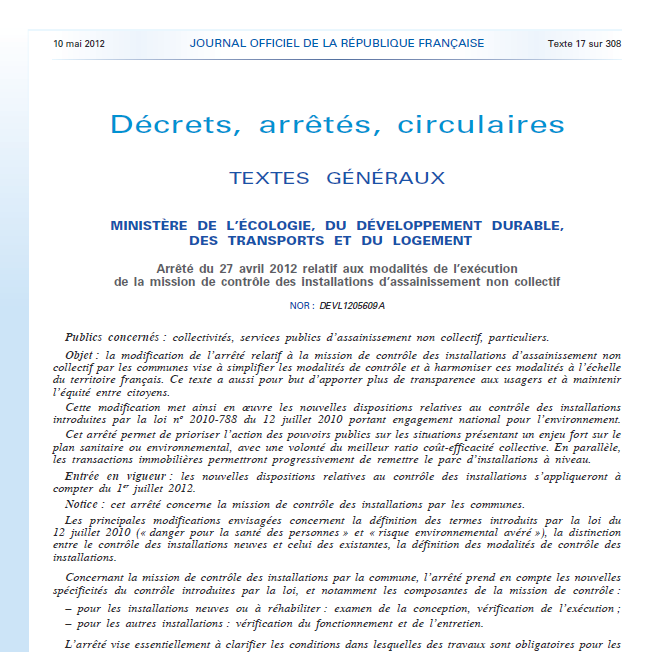
Arrêté du 27 avril 2012
Arrêté relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. Comprend en Annexe 3 "les points à vérifier dans le cas particulier des toilettes sèches".
Il n’existe pas de réglementation précise concernant les toilettes sèches. Toutefois, la question écrite d’une élue du Morbihan au Ministre de l’Écologie, concernant des toilettes sèches en zone d’assainissement collectif a permis d’ouvrir le débat. Une réponse claire qui fait jurisprudence a été apportée le 19 avril 2011 et publiée au Journal Officiel : «ce type d’installation est autorisé, y compris dans les zones d’assainissement collectif».
À la suite de la parution de l’arrêté du 7 septembre 2009, la Direction Générale de la Santé (DGS) s’est intéressée à la question de l’installation de toilettes sèches dans les lieux publics : ERP et manifestations éphémères.
En 2010, un message a été transmis par la DGS aux Agences Régionales de Santé (ARS) lève l’interdiction (d’installation de toilettes sèches dans les ERP) sous réserve du respect d’une dizaine de recommandations :
- Des points d’eau potable pour le lavage des mains doivent être disponibles à proximité immédiate des toilettes et en nombre suffisant. Ils sont équipés de produit de nettoyage des mains et d’un dispositif d’essuyage ou de séchage
- Un protocole de nettoyage doit être mis en œuvre pour la gestion sanitaire des parois du conduit des WC. A minima, une inspection horaire des WC s’impose
- Sur le plan de la gestion des matières récupérées, il est impératif que puisse être mise en œuvre une filière de traitement par compostage des matières fécales à des fins d’hygiénisation
- Les conditions de compostage des matières fécales doivent être maîtrisées :
– stockage sur une zone étanche, avec transfert des liquides éventuellement produits vers une zone de traitement par épandage correctement dimensionnée
– stockage sur une zone couverte, afin d’éviter une lixiviation importante des matières solides provoquée par les pluies
– conditions de retournement fixées à 4 fois par an, afin d’augmenter la maturation du compost
– apport en début de compostage de sciures de bois ou autres copeaux, dans un ratio estimé à 1 pour 1 dans le cas de matières fécales mélangées aux urines
– temps de maturation du compost d’une durée de deux ans avant épandage - A défaut de compostage mis en œuvre selon les conditions présentées ci-dessus, toute opération d’assainissement par toilettes sèches en ERP doit être couplée à une possibilité de dépotage des matières en station d’épuration
- L’épandage direct des matières fécales doit être interdit.
Gestion des matières
La gestion des déchets a d’abord été régie par les deux principaux textes de la loi du 15 juillet 1975, liée directement aux déchets, et la loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Ces textes ont ensuite été codifiés sous forme de Code de L’environnement (ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000) qui est composé de 2 parties législative et réglementaire :
- Le livre V titre I de la partie législative traite des ICPE
- Livre V Titre IV relatif aux déchets.
Chaque producteur de déchets, qu’il s’agisse d’une collectivité locale ou d’un industriel est responsable de ses déchets, et des conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou recyclés (article L. 541-1).
Ainsi, l’activité de transport et collecte prend, en France, la forme d’une déclaration auprès du préfet du département ou se situe le siège de l’entreprise. Les conditions de déclaration – valable 5 ans – sont mentionnées aux articles R.541-50 et suivants du code de l’environnement. Elle est nécessaire dès lors que la quantité transportée dépasse, par chargement, 0,1 t de déchets dangereux et 0,5 tonne pour les autres déchets.
Hormis les recommandations émises par la Direction Générale de la Santé (voir section ci-dessus « Toilettes sèches dans les ERP ») aucune réglementation explicite n’encadre les techniques de toilettes sèches mobiles pour des évènements ponctuels ni les filières relatives à la gestion de leurs matières. Leur absence dans la réglementation (notamment la caractérisation sémantique) fait qu’il est difficile de les assimiler à un cadre spécifique. Le traitement de ces matières pourrait être encadrés par les normes NF U44-095 (Amendements organiques – Composts contenant des matières d’intérêt agronomique, issues du traitement des eaux) et NF U44-051 (Amendements organiques – Dénominations, spécifications et marquage). Cependant, selon la technique de collecte, le traitement divergera et le produit final aussi. Ainsi, des produits liquides ou secs peuvent être obtenus et de par leur composition n’avoir aucun intérêt à être rattachée à l’une de ces normes/réglementations.
Les toilettes sèches, quelle que soit la manière de collecter les urines et les fèces, nécessitent un traitement par compostage, de tout ou partie des produits collectés. Ainsi, s’intéresser aux réglementations spécifiques liées au compostage est nécessaire pour parfaire le tour d’horizon pouvant s’appliquer aux matières récoltées. Les installations de compostage relèvent :
- du Règlement Sanitaire Départemental (article 158) ;
- de l’Arrêté du 7 janvier 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2170 : « engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques » et mettant en œuvre un procédé de transformation biologique aérobie (compostage) des matières organiques ;
- de l’Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre I du livre V du code de l’environnement.
Le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées définit les conditions dans lesquelles le retour au sol des boues peut être réalisé sur des sols agricoles ou forestiers. Il établit les règles générales d’hygiène et toute autre mesure propre à préserver la santé de l’homme.
L’arrêté du 31 janvier 1998 fixe des « valeurs seuils » maximales en polluant tels que les ETM, CTO, des paramètres physico-chimiques et microbiologiques sur les boues de STEP et définit le périmètre d’épandage sur les sols agricoles (sur la base d’analyses de sol) et les délais de réalisation des épandages. De même pour l’arrêté du 2 février 1998 qui décrit les modalités de réalisation de l’épandage des boues issues d’ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) et précise le contenu de l’étude de sol préalable, les doses maximales admissibles afin d’éviter les effets nocifs sur les sols, la végétation, les animaux et l’homme, tout en encourageant leur utilisation correcte et la notion de protection de l’environnement.